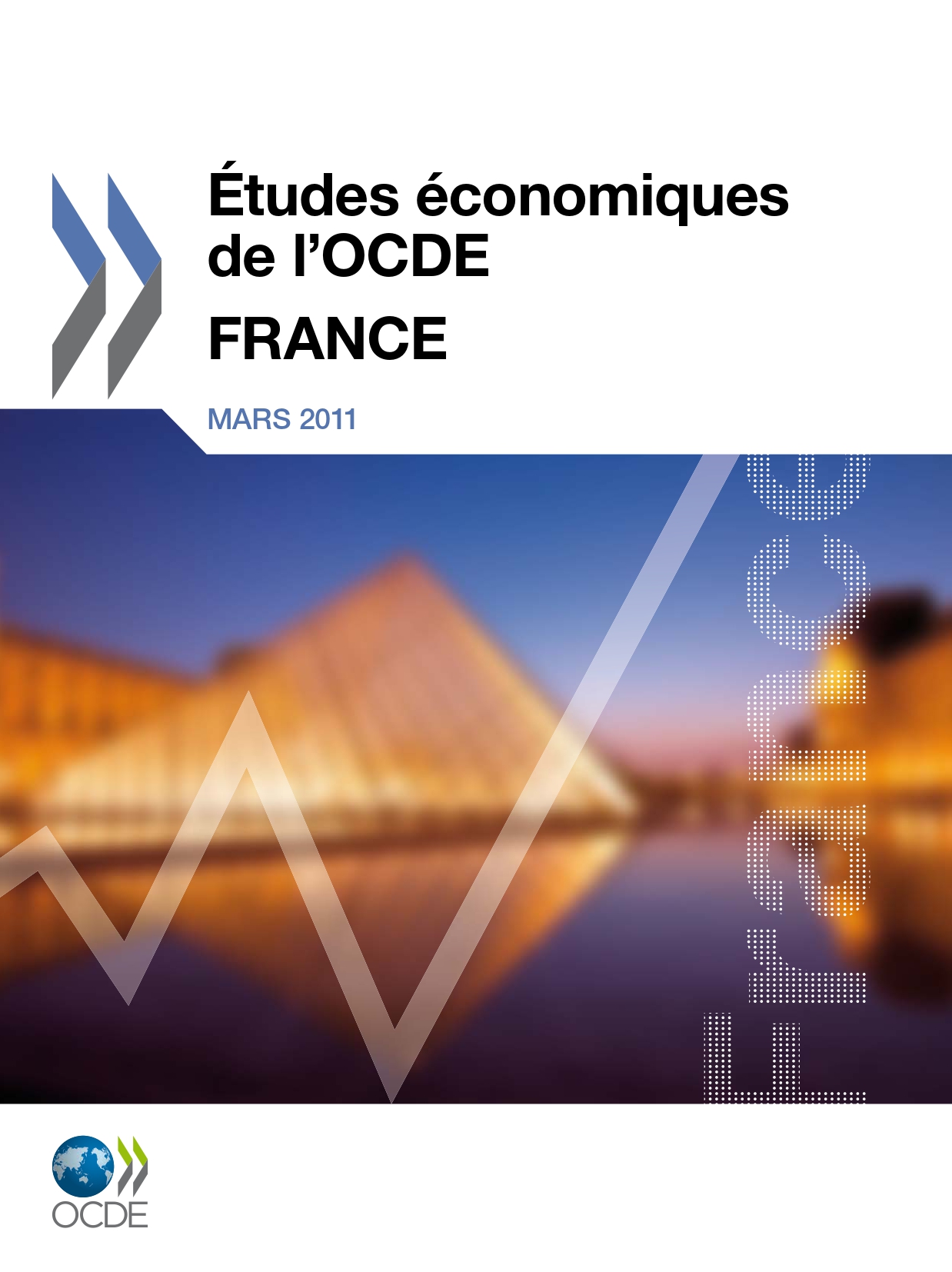
Préfacier : OCDE
Avant-propos : OCDE
Collection :
Editeur : OCDE
Auteur (s): OCDE
Une reprise modeste est enclenchée, mais la récession va laisser des traces durables.
La France se trouve dans une situation intermédiaire parmi les pays de l’OCDE en termes d’impact de la crise. Des facteurs divers, y compris la réaction appropriée de la politique macroéconomique, ont permis à l’économie de résister au choc. Mais la nature financière et globale de la récession suggère que la reprise sera probablement modérée, la croissance du PIB se redressant progressivement pour atteindre 2 % en 2012. Ce rythme sera sans doute insuffisant pour faire refluer rapidement le chômage. Les performances à l’exportation se sont améliorées en 2010 et l’investissement privé devrait devenir le principal relais de la croissance. Bien qu’il y ait un manque d’offre de logements dans des zones dites tendues, le marché immobilier est sans doute vulnérable en cas de remontée des taux. Dans le contexte de turbulence sur certains marchés obligataires de la zone euro, les priorités doivent porter sur l’assainissement budgétaire, l’accroissement des taux d’emploi et la stimulation de l’offre productive.
La France doit rompre définitivement avec la dérive des comptes publics afin d’éviter que la stabilité macroéconomique ne soit menacée. La réforme des retraites 2010 atteste de la détermination des autorités dans ce domaine. Le rythme d’assainissement prévu par le gouvernement jusqu’en 2014 est approprié, mais les mesures permettant d’y parvenir doivent être rapidement précisées. À moyen terme, l’équilibre budgétaire devrait être visé. Pour consolider cet effort et asseoir la crédibilité du gouvernement, la France aurait intérêt à se doter d’un cadre budgétaire renforcé à valeur constitutionnelle consistant en une règle de déficit structurel qui pourrait reposer sur des plafonds de dépenses et des planchers de recettes, en une programmation budgétaire pluriannuelle et un conseil budgétaire indépendant. L’effort de réduction du déficit devra porter en priorité sur les dépenses, en rendant les administrations publiques plus efficaces et en maîtrisant mieux les dépenses liées au vieillissement. Côté recettes, il faut continuer d’élaguer les « niches » fiscales et sociales inefficaces, et envisager de relever les impôts les moins nocifs, notamment les taxes sur les externalités environnementales, la propriété et la TVA.
Le fonctionnement du marché du logement peut être sensiblement amélioré. Les politiques publiques devraient s’articuler davantage autour de trois axes : aides personnelles sous conditions de ressources ; soutien direct et efficace à l’offre en zones tendues, notamment via le secteur social recentré sur les ménages défavorisés ; et réduction de certaines entraves aux mécanismes de marché, afin de rendre l’offre plus réactive, le marché plus fluide, et les distorsions plus limitées. Pour ce faire, les loyers des ménages du secteur social ayant des revenus supérieurs à la médiane doivent être rapprochés des niveaux de marché, et l’indice d’indexation des loyers du secteur privé révisé. Priorité doit être donnée : à la mise à jour des valeurs locatives cadastrales ; à la réduction des avantages fiscaux associés à la résidence principale ; au basculement progressif de la fiscalité sur les transactions vers la taxe foncière ; à la libération des terrains constructibles et au relèvement des coefficients d’occupation des sols ; au rééquilibrage des rapports locatifs ; et à la réduction des coûts effectifs liés à la prise d’hypothèque. La réforme du logement social passe en outre par le regroupement des organismes HLM à un niveau supra communal et la révision du mode d’allocation des logements sociaux. Le gouvernement devrait enfin évaluer le mode de financement du logement social spécifique à la France au travers d’une analyse coûts-bénéfices prenant en compte les distorsions probablement importantes qu’il est susceptible d’engendrer. Les politiques environnementales doivent s’assurer que les coûts d’abattement sont minimisés, la politique de changement climatique étant au premier plan. Les coûts d’abattement des émissions de gaz à effet de serre devraient être harmonisés entre les différentes sources d’énergie, la pluralité des externalités à corriger n’impliquant toutefois pas qu’une égalisation stricte des taxes soit nécessaire. Une taxe carbone constitue en principe l'un des principaux instruments pour réduire les émissions de gaz à effets de serre, et il est regrettable que le Conseil constitutionnel ait rejeté une première tentative du gouvernement en ce sens. Dans tous les cas, il faudrait s’efforcer de limiter l’hétérogénéité considérable de la tarification implicite du carbone, qui ne permet pas de réduire efficacement ces émissions. Il s’agit notamment de relever les taxes applicables au gaz naturel, au charbon, au fioul domestique et au diesel, et de réduire les dépenses fiscales dont bénéficient les plus gros utilisateurs de carburants, sur la base notamment des coûts d’abattement. Les coûts de traitement des déchets nucléaires devraient être mieux comptabilisés et la gestion des ordures ménagères et de la pollution des eaux améliorée.
© 2016- ESAE – L’excellence a un nom ! – Tous droits réservés | Conception & réalisation : DIGIWEB SARL
